
Le lobby de l’industrie des semences
Qu’est-ce qui se cache derrière la campagne de relations publiques « Partenaires pour l’innovation » ?
Nombreux sont ceux qui ont vu la lettre de Partners in Innovation envoyée aux médias pour tenter de contrecarrer la campagne de la Nationale des Fermiers contre le projet de loi C-18. L’UNF a soigneusement analysé la législation proposée et a alerté les fermiers et le grand public sur les graves implications négatives de ce projet de loi. Les gens ont réagi de manière appropriée, en diffusant l’information et en construisant une résistance. Il est clair que le lobby des semences est inquiet.
Qui sont les partenaires en innovation ?
Partners in Innovation est ce que l’on appelle souvent un groupe « Astroturf » – un faux groupe de base. Alors qu’il prétend représenter les fermières, un examen plus approfondi révèle qu’il s’agit en fait d’un porte-parole de l’industrie semencière. Partnersfait partie d’une campagne de relations publiques orchestrée, spécialement conçue pour contrer l’opposition anticipée au programme du gouvernement fédéral visant à mettre en œuvre l’UPOV 91 au Canada.
Partenaires en innovation est apparu pour la première fois sur la scène publique le 9 décembre 2013, le jour même où le projet de loi C-18 a été présenté à la Chambre des communes. Les douze organisations membres des partenaires ont soutenu la législation avant même que son texte ne soit rendu public. Bien qu’ils prétendent représenter des dizaines de milliers de fermiers, les dirigeants des organisations membres ont proclamé leur soutien au projet de loi avant que leurs membres n’aient eu le temps de le lire, et encore moins d’en débattre et de prendre une décision éclairée à son sujet.
Il convient également de noter que l’adhésion à de nombreux groupes qui composent le réseau Partenaires pour l’innovation n’est pas volontaire. Par exemple, tous les fermiers de l’Ontario qui vendent du blé, du maïs ou du soja doivent adhérer à Grain Farmers of Ontario, quelle que soit leur opinion sur la politique agricole. De même, des groupes tels que l’Alberta Barley Commission, l’Alberta Wheat Commission, l’Atlantic Grains Council, le Barley Council of Canada, les Manitoba Pulse Growers et la Prairie Oat Growers Association obtiennent leur adhésion par le biais de prélèvements obligatoires. Les fermiers sont tenus de verser un pourcentage de leurs ventes à ces organisations pour soutenir la recherche et la commercialisation des cultures – là encore, indépendamment de leurs opinions sur les questions de politique agricole. La manière dont ces organisations élaborent leurs positions politiques est un mystère pour la plupart d’entre nous.
Un examen rapide des sources de financement des membres de Partners in Innovation montre que le gouvernement fédéral et les entreprises du secteur des semences exercent une influence considérable sur les organisations.
Deux groupes de Partenaires pour l’innovation – l’Association canadienne du commerce des semences (AC S) et Cereals Canada – sont dominés par des entreprises mondiales de semences et des négociants en grains. Le conseil d’administration de l’ACTS comprend des représentants de BASF Canada Inc., Bayer CropScience, Hyland Seeds (DowAgro Sciences), Monsanto Canada, Pioneer Hi-Bred Ltd. (DuPont), Richardson International et Syngenta Canada. Le conseil d’administration de Céréales Canada comprend des représentants de Dow AgroSciences, Cargill Canada, Bayer CropScience Inc, Syngenta Canada, Richardson International et Viterra, ainsi que des représentants de l’Alberta Wheat Commission et de Grain Farmers of Ontario, qui sont tous deux membres de Partners in Innovation.
Il existe également un chevauchement considérable entre les Producteurs de grains du Canada (GGC) et Partners in Innovation. Six des seize partenaires actuels sont représentés au conseil d’administration de la CGG : l’Alberta Barley Commission, l’Alberta Wheat Commission, l’Atlantic Grains Council, la British Columbia Grain Producers Association, la Manitoba Pulse Growers Association et la Prairie Oat Growers Association. En outre, en 2012, Syngenta a parrainé un cours de deux jours sur la défense des intérêts et le lobbying politique pour le conseil d’administration de GGC.
Syngenta est également nommée « entreprise leader » de la Fédération canadienne de l’agriculture et apporte un financement important au Conseil canadien de l’horticulture, aux Grain Farmers of Ontario et à l’Association des producteurs de blé de l’Ouest canadien.
D’autres géants de l’industrie des semences – BASF, Bayer, Dow AgroSciences, DuPont et Monsanto – fournissent également des fonds et des parrainages à ces membres des partenaires: la Fédération canadienne de l’agriculture, le Conseil canadien de l’horticulture, la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, Grain Farmers of Ontario et l’Association manitobaine des producteurs de légumineuses.
Certains partenaires reçoivent un financement d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Plusieurs d’entre eux ont obtenu des subventions dans le cadre des programmes Cultivons l’avenir et Cultivons l’avenir 2. Comme l’a fait remarquer le rédacteur en chef du Manitoba Co-operator, John Morriss, dans son éditorial intitulé » Keeping the farm organizations in line« , les groupes semblent de plus en plus obligés de fournir au gouvernement un soutien en matière de relations publiques en échange d’un financement. « Si [a given organization] veut obtenir d’AAC qu’il verse des fonds de contrepartie (bien que moins que ce qu’il a dépensé auparavant), il doit jouer le jeu, y compris en disant des choses gentilles dans le communiqué de presse du gouvernement ». [1]
Certains des partenaires impliqués dans la recherche peuvent également penser que, le financement public devenant moins sûr ou étant complètement supprimé, les paiements de redevances plus élevés au titre du droit d’obtenteur, rendus possibles par l’UPOV 91, seront leur seule alternative pour financer les futurs efforts de sélection végétale. Peu importe que les redevances qui constituent la source de ces fonds de recherche soient payées par leurs membres fermiers lorsqu’ils achètent des semences chaque année. Ces organisations sont donc en conflit d’intérêts. Les organisations de prélèvement mettent les semences de leurs nouvelles variétés à la disposition des fermières dont l’argent du prélèvement a servi à financer la sélection, ou bien elles soutiennent la privatisation du retour sur les semences prévue par l’UPOV 91, perçoivent des redevances plus élevées sur les variétés développées avec l’argent des membres et utilisent les recettes pour faire fonctionner l’organisation. Leurs attentes quant à la capacité du C-18 à générer des revenus pourraient toutefois ne pas porter leurs fruits s’ils doivent partager les redevances avec les entreprises partenaires qui seront de plus en plus propriétaires du matériel génétique.
Malheureusement, les membres de Partners in Innovation, qui devraient veiller aux intérêts plus larges de leurs membres fermiers, ont apparemment accepté la directive du gouvernement selon laquelle « il n’y a pas d’alternative ». Au lieu de réagir et d’exiger le rétablissement du financement public de la sélection végétale, ils ont acquiescé.
D’où vient le financement de l’UNF et comment prenons-nous les décisions ?
En revanche, la Nationale des Fermiers a depuis longtemps pour politique de ne pas chercher à obtenir de financement de la part des entreprises ou du gouvernement pour ses opérations. Les fonds de fonctionnement de l’UNF proviennent des cotisations des membres. L’UNF est la seule organisation agricole nationale à adhésion volontaire. La diversité des membres de l’UNF comprend un large éventail de producteurs, des fermières céréalières aux producteurs laitiers en passant par les petits maraîchers, biologiques et conventionnels, de tout le pays. Seuls les fermiers peuvent être membres à part entière avec droit de vote. Les positions politiques de l’organisation sont élaborées par le biais d’un processus démocratique de base dans le cadre duquel les résolutions sont débattues lors des conventions annuelles et adoptées par un vote majoritaire des délégués. Tous les membres du bureau sont élus parmi les membres. Le processus décisionnel de l’UNF est transparent, les intérêts de nos membres sont toujours prioritaires et notre voix collective n’est pas entravée.
Réponse à la lettre des partenaires à la rédaction
En ce qui concerne la lettre récente de Partners for Innovation , il ne faut pas s’étonner qu’elle contienne de nombreuses contradictions, hypothèses et interprétations qui profitent aux multinationales des semences plutôt qu’aux fermières canadiennes. Après tout, le programme » Partenaires pour l’innovation » a été créé dans le cadre d’une stratégie de relations publiques visant à vendre au public et aux fermiers une législation désagréable – il n’a pas d’autre raison d’être. Si le projet de loi C-18 reposait sur ses propres mérites, il n’y aurait pas besoin de l’intervention de ce groupe « Astroturf » soutenu par l’industrie. Par conséquent, ses déclarations doivent être considérées avec un degré élevé de scepticisme. La première question à se poser est la suivante : « Quels sont les intérêts servis ? ».
D’une part, Partners for Innovation affirme que C-18 est nécessaire pour financer davantage de recherche au Canada afin de développer de nouvelles variétés adaptées à nos conditions. D’autre part, les partenaires affirment que le C-18 est nécessaire pour que les entreprises puissent importer des variétés qu’elles ont développées dans et pour d’autres pays.
Ils suggèrent que le Canada est en porte-à-faux sur le plan international en ne se conformant pas à l’UPOV 91, alors que sur les 190 pays du monde, seuls 71 (37%) ont signé l’UPOV. Comme le Canada, 19 de ces pays utilisent l’UPOV 78 : l’Afrique du Sud, l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la Colombie, l’Équateur, l’Italie, le Kenya, le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Paraguay, le Portugal, la Trinité-et-Tobago et l’Uruguay, tandis que la Belgique continue d’utiliser l’UPOV 1961/72[2].
Une deuxième question clé devrait être « où ira l’argent des redevances ? ». Il n’y a aucune garantie que tous les revenus des redevances seront investis dans la recherche. Rien ne garantit non plus que ces sociétés dépenseront leurs redevances au Canada au profit des fermières canadiennes. Rien ne garantit non plus que les variétés importées donneront de bons résultats au Canada, d’autant plus que les dispositions du projet de loi C-18 autoriseraient l’utilisation d’études étrangères dans la prise de décisions réglementaires. Ces mêmes clauses permettraient au lobby des semenciers de poursuivre son attaque contre le système d’enregistrement des variétés au Canada, en cherchant à réduire les examens par des tiers indépendants et à abaisser les normes de qualité. Une seule chose est garantie par le projet de loi C-18 : les entreprises qui détiennent des droits d’obtenteur verront leurs redevances augmenter. Une fois qu’ils auront reçu l’argent, il leur appartiendra de décider comment le dépenser.
Partners in Innovation affirme que les nouvelles variétés développées par les entreprises de semences profiteront aux fermières en leur fournissant de nouveaux gènes, des variétés de cultures améliorées, des rendements plus élevés et davantage de débouchés commerciaux. Toutefois, les sélectionneurs privés doivent se concentrer sur les priorités de l’entreprise, à savoir les revenus et les bénéfices. Jamie Larsen, PhD, chercheur à Agriculture et Agroalimentaire Canada à Lethbridge[3], déclare ce qui suit :
« Les sélectionneurs privés travaillent pour des entreprises qui ne fonctionnent que si elles réalisent des bénéfices ; l’approche de la sélection doit donc être directe, avec un produit commercialisable clair comme résultat final. Les sélectionneurs publics fonctionnent généralement grâce au financement de base de leur organisation, mais ils obtiennent des niveaux importants de financement pour leurs programmes de la part d’organismes de financement qui s’intéressent à la recherche ciblée pour faire face à une menace spécifique ou à la recherche sur le bien public à long terme ».
Partners in Innovation affirme que les investissements canadiens dans la recherche sur les céréales sont faibles et que, par conséquent, notre productivité est faible. En réalité, la réduction du financement de la sélection céréalière est le résultat de la politique du gouvernement fédéral, un choix politique et idéologique. En 2013, AAC a annoncé sa décision de cesser de financer la quasi-totalité de sa sélection publique de blé, affirmant que les entreprises privées refusaient d’investir tant que le secteur public était impliqué. En outre, le fait est que le retour sur investissement de la sélection céréalière est élevé, les estimations allant de 20 à 50 dollars pour chaque dollar investi[4]. Ces avantages ont profité aux fermières, à leurs clients, aux communautés rurales et à l’économie canadienne dans son ensemble.
Le problème ne réside pas dans la valeur de la recherche céréalière, mais dans les politiques gouvernementales qui ont abandonné le développement des variétés publiques et leur projet de vendre le matériel génétique développé par les sélectionneurs publics pour que les entreprises privées l’utilisent et en tirent profit. La clé du succès de cette stratégie de l’entreprise et du gouvernement est que les fermières paient des redevances plus élevées pour les semences. Par conséquent, l’UPOV 91 vise moins à attirer les investissements qu’à obliger les fermières à payer davantage les entreprises privées pour leurs achats annuels de semences, afin que les bénéfices considérables de la sélection céréalière profitent à leurs actionnaires plutôt qu’à l’intérêt public.
L’affirmation de Partners in Innovation selon laquelle l’utilisation des droits d’obtenteur est volontaire est techniquement correcte mais également trompeuse. Oui, la demande de droits d’obtenteur est volontaire, mais il est très improbable qu’un éleveur ne le fasse pas. La directive du budget fédéral de 2012 a empêché les obtenteurs publics de développer des variétés pour les principales cultures, de sorte qu’il n’y aura pratiquement plus de nouvelles variétés publiques éligibles aux droits d’obtenteur. Il est peu probable que les obtenteurs privés renoncent à la possibilité de percevoir des redevances et/ou d’empêcher d’autres personnes d’utiliser ces variétés.
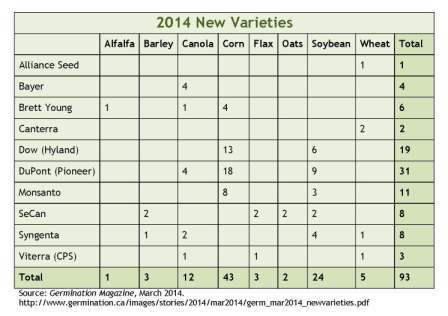
Les fermières peuvent utiliser des variétés plus anciennes qui ne sont plus protégées par le droit d’obtenteur – du moins pour l’instant. La nouvelle réglementation entrée en vigueur le 4 juin 2014 permet aux titulaires d’enregistrements de variétés de les désenregistrer à leur guise. Si de nombreuses variétés sont actuellement dans le domaine public, dans certains types de cultures, comme la luzerne, le soja, le canola et les pommes de terre, la plupart sont enregistrées par des sociétés privées et sont donc susceptibles d’être désenregistrées. Au fil du temps, de nombreuses variétés libres de droits actuellement disponibles pourraient être retirées du commerce.
Les organisations de prélèvement des agriculteurs ont permis aux fermiers de soutenir la sélection végétale d’intérêt public – dans les céréales et les légumineuses, par exemple, en cofinançant des projets avec les gouvernements et les universités – tout en permettant aux agriculteurs d’avoir leur mot à dire sur les objectifs de la recherche, concrétisant ainsi les priorités des agriculteurs en matière de variétés. Les droits d’obtenteur constituent également une source de revenus pour les sélectionneurs publics – une source qui pourrait bien être le dernier recours dans le contexte d’une décennie de décisions politiques visant à réduire le financement public de la sélection végétale et d’autres recherches dans l’intérêt public.
Partners in Innovation mentionne que les détenteurs de droits d’obtenteur sont tenus de mettre leurs variétés à la disposition d’autres sélectionneurs à des fins de recherche, mais ils omettent de préciser que les variétés « essentiellement dérivées » de ces stocks seraient la propriété de la première entreprise et non du chercheur qui sélectionnerait d’autres variétés. Cela signifie que les entreprises semencières qui obtiennent ou développent de nouveaux germoplasmes ont également des droits de propriété sur les futures variétés potentielles, même si elles ne développent pas elles-mêmes ce matériel. Par conséquent, les obtenteurs indépendants ne seraient guère incités à travailler avec des variétés protégées par le droit d’obtenteur. En outre, en exigeant des sélectionneurs publics du Canada qu’ils vendent le matériel génétique qu’ils ont développé, le gouvernement fédéral privatise également toutes les futures variétés qui seront développées à partir de ces lignées.
Partners in Innovation induit également en erreur en affirmant que le projet de loi C-18 permet aux fermières de stocker des semences pour les utiliser sur leurs propres exploitations. En fait, l’article 5.3(2) du projet de loi C-18 n’exempte les fermières que des droits exclusifs des titulaires de droits d’obtenteur « a) de produire et de reproduire du matériel de reproduction de la variété « et « b) de conditionner du matériel de reproduction de la variété aux fins de la reproduction de la variété« . Le droit de stocker, c’est-à-dire « g) de stocker du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété aux fins de l’accomplissement de l’un quelconque des actes décrits aux alinéas a) à f) » reste fermement entre les mains de l’obtenteur[5].
Partners in Innovation minimise le pouvoir accordé par le projet de loi C-18 aux entreprises de percevoir des redevances sur les cultures issues de semences pour lesquelles des redevances n’ont pas été perçues, suggérant que cela ne se produirait que dans le cas de semences acquises illégalement. En fait, le commerce des semences propose et promeut un système de redevances au point final pour obtenir des paiements de redevances sur les cultures produites à partir de semences de ferme (FSS). Leur interprétation est que le SIV – même avec le privilège des fermiers – refuse à la société une possibilité raisonnable de percevoir une redevance.
« Les normes UPOV 91 prévoient que si l’obtenteur n’a pas la ‘possibilité raisonnable’ d’exercer son droit de percevoir une redevance sur la semence (dans ce cas, le SIV ou la semence certifiée), l’obtenteur peut percevoir une redevance sur le grain qui est produit à partir de la semence. Lorsque la redevance est perçue sur le grain récolté et non sur la semence, on parle de redevance au point final (RPT) »[6].
Partners in Innovation a soigneusement formulé sa déclaration selon laquelle « le projet de loi C-18 ne permet pas au ministre de supprimer le privilège des fermières ». En fait, ce pouvoir incomberait au gouverneur en conseil (cabinet), et non au ministre. Le projet de loi C-18 modifierait la loi sur la protection des obtentions végétales comme suit :
75. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, il peut prendre des règlements …
(l.1) concernant les catégories de fermiers ou de variétés végétales auxquelles le paragraphe 5.3(2) ne s’applique pas ;
(l.2) concernant l’utilisation du produit de la récolte au titre du paragraphe 5.3(2), y compris les circonstances dans lesquelles cette utilisation est restreinte ou interdite et les conditions auxquelles elle est soumise ;
[7]
Le processus de modification de la réglementation prévoit des consultations et un examen public, mais il appartient à la bureaucratie ministérielle de décider de l’ampleur de la consultation et des personnes consultées. En outre, rien n’oblige à prendre en compte les avis exprimés par le public dans la formulation finale du règlement, et les propositions de règlement ne sont pas débattues à la Chambre des communes ou dans l’une de ses commissions. Si le projet de loi C-18 est adopté, nous pouvons nous attendre à ce que la réglementation récupère les mesures relatives au privilège des fermières.
Le programme « Partenaires pour l’innovation » fait partie d’une stratégie de relations publiques visant à promouvoir une législation dont le gouvernement et l’industrie des semences savaient qu’elle serait impopulaire. Les bénéficiaires de l’UPOV 91 sont clairement les entreprises semencières mondiales qui devraient bénéficier de nouvelles sources de revenus et d’une réduction des coûts, ainsi que d’une augmentation de leur part de marché et d’une plus grande influence sur l’alimentation et l’agriculture. L’industrie mondiale des semences utilise Partners in Innovation pour tenter de saper la campagne très réussie de l’UNF qui a éduqué et mobilisé le public canadien grâce à nos recherches approfondies, à notre analyse critique et à l’action communautaire efficace de nos membres et de nos alliés.
L’UNF a non seulement examiné le projet de loi C-18 d’un œil lucide, mais elle a également proposé une vision alternative : rétablir les programmes publics de sélection végétale pour les cultures majeures et mineures dans l’intérêt des fermières canadiennes et créer et adopter une loi sur les semences pour les fermières[8]. Nous pensons qu’en tant que société, nous pouvons orienter notre politique agricole dans une direction différente pour le bien de notre environnement et pour mettre la souveraineté alimentaire au premier plan.
Les Canadiens écoutent la Nationale des Fermiers et agissent avec elle parce qu’ils reconnaissent que nous disons la vérité au pouvoir.
Annexe A :


[1] Éditorial : Keeping the farm organizations in line, par John Morriss. Manitoba Co-operator, 16 décembre 2013. https://tinyurl.com/n3nothr
[2] Membres de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) http://www.upov.org/export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf
[3] Plant Breeders’ Perspectives, Germination Magazine, janvier 2014. https://tinyurl.com/pya4llx
[4] R&D dans le secteur céréalier canadien : Retour à la recherche agricole http://words.usask.ca/cgpc/about-the-chairholder/
[5] Projet de loi C-18, Loi sur la croissance agricole. http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=E&Mode=1&billId=6373658
[6] End Point Royalties, par Stuart Garven, Germination Magazine, janvier 2014. https://tinyurl.com/lamh66w
[7] Projet de loi C-18, Loi sur la croissance agricole. http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=E&Mode=1&billId=6373658
[8] Principes fondamentaux d’une loi sur les semences fermières, UNF, 2014. http://www.nfu.ca/issue/fundamental-principles-farmers-seed-act